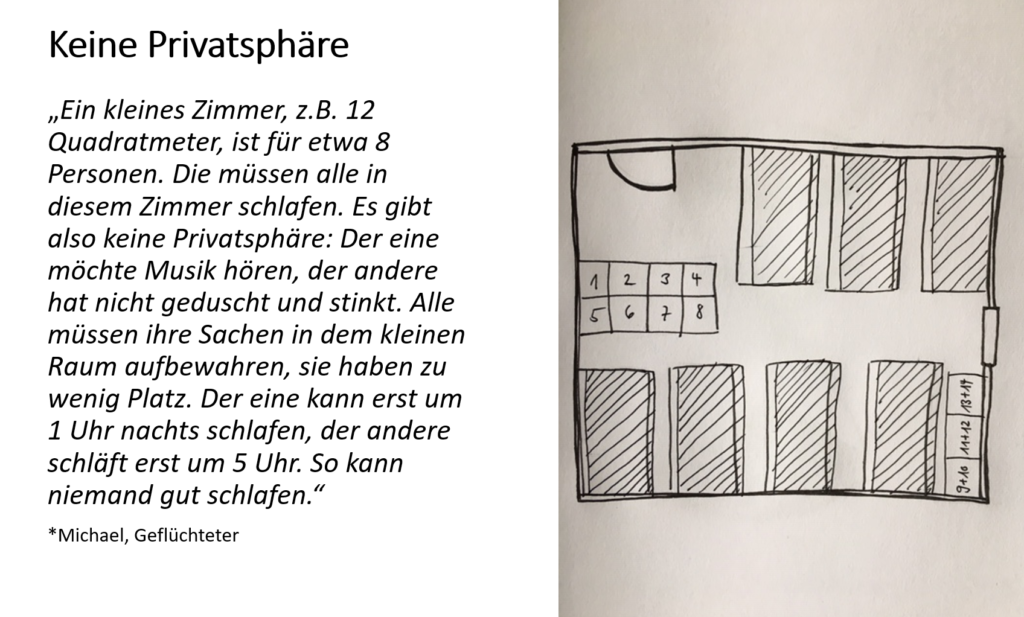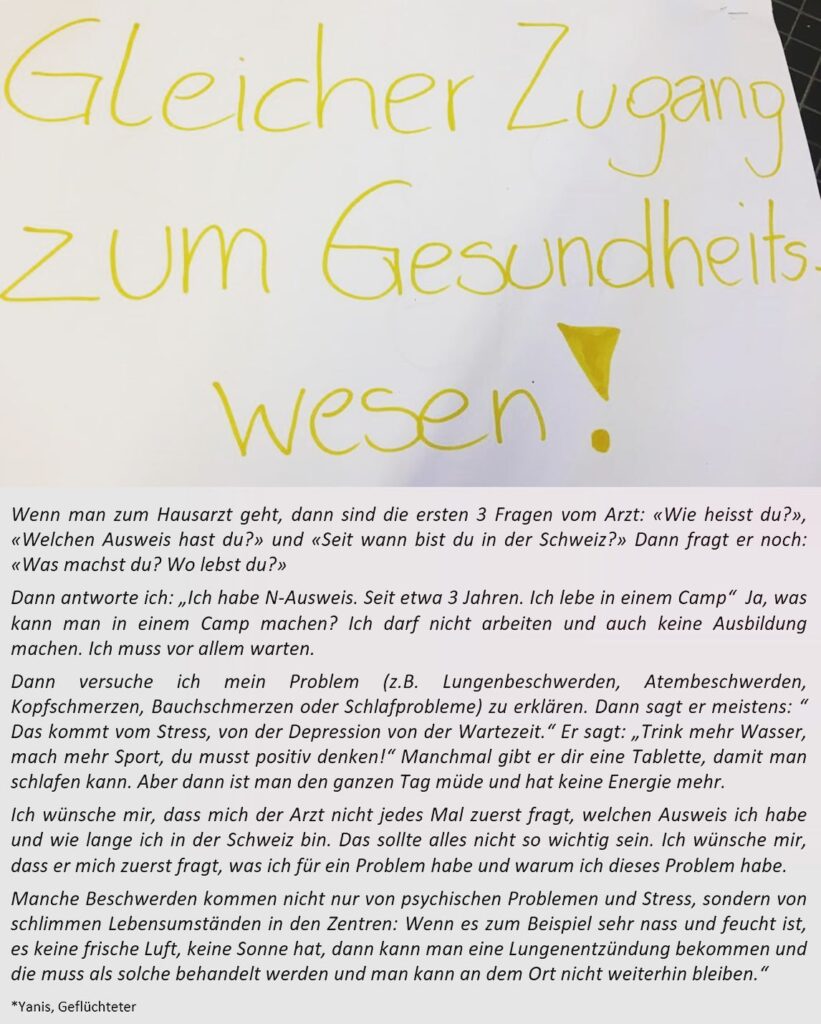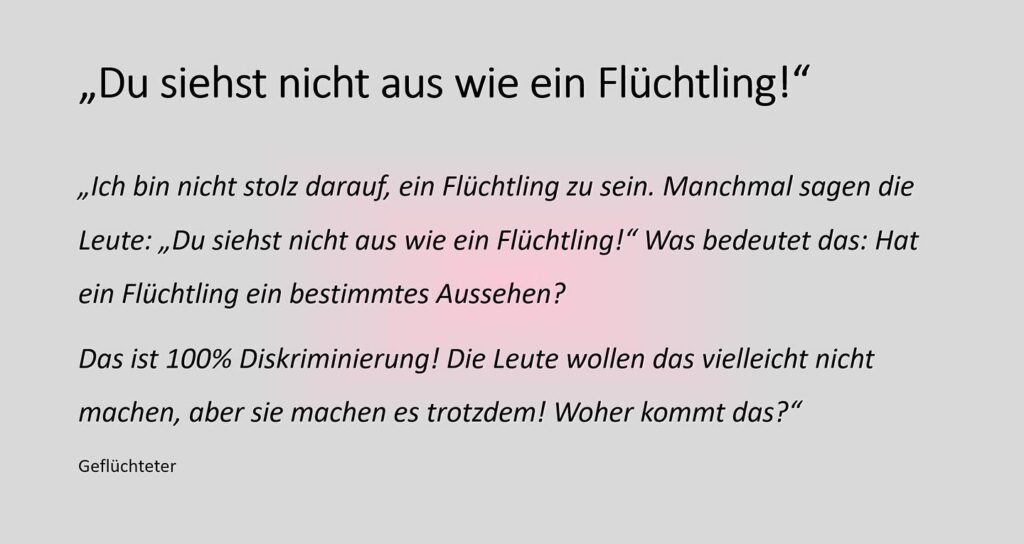DE: Im Vorfeld der Demonstration „Asylcamps sind keine Lösung“ am 9. November 2019 haben uns Geflüchtete Erfahrungsberichte zum Leben in Camps geschickt.
EN: In the run-up to the demonstration „Asylum camps are not a solution“ on November 9, 2019, we are publishing testimonials about the experiences made in camps.
FR: En vue de la manifestation „Les camps d’asile ne sont pas une solution“ du 9 novembre 2019, nous publions des témoignages sur la vie dans les camps.
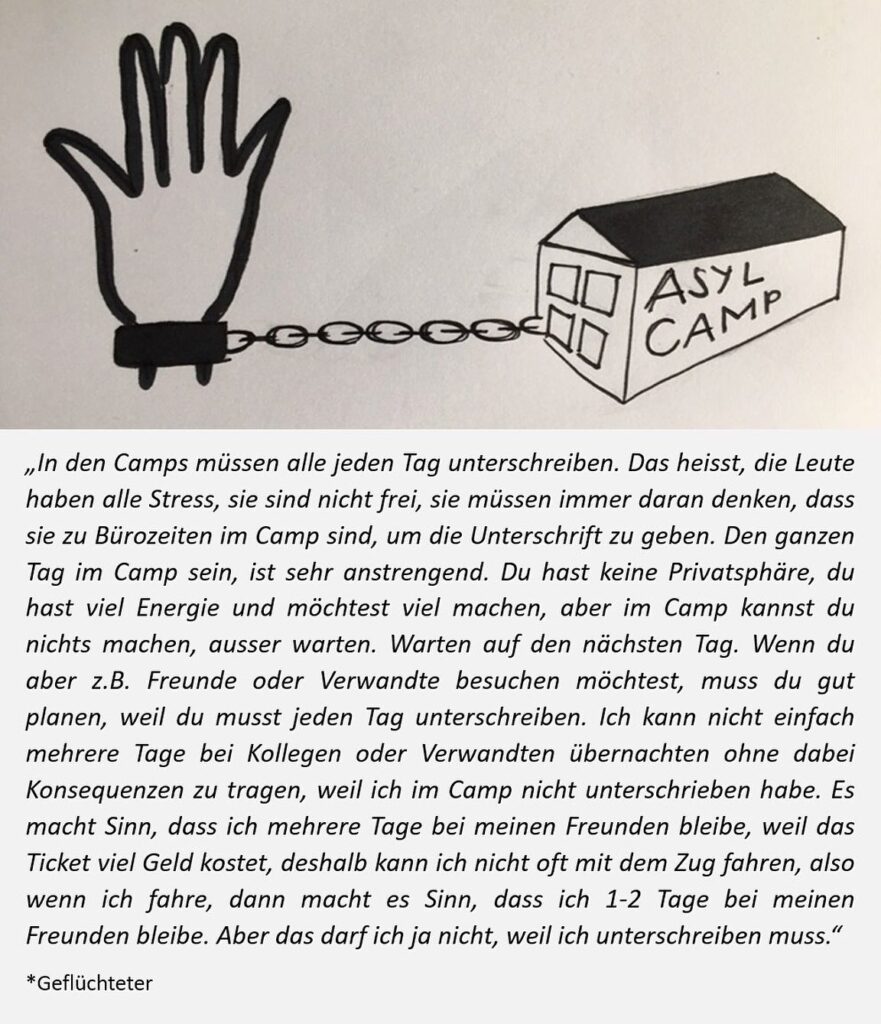
Eine Wahl zwischen Hölle und Hölle
„Ich kam mit meiner vier Monate alten Tochter und meinem Mann in die Schweiz ins Asylcamp nach Kreuzlingen. Unser Asylantrag wurde als Familie bearbeitet und als Verantwortlichen dafür der Name meines Mannes notiert.
Nach zwei Wochen wurde ich von meinem Mann geschlagen und ich bat die Security im Camp um Hilfe, doch niemand nahm mich ernst. Nach weiteren drei Tagen wurden ich und meine Tochter erneut geschlagen. Mein Kind blutete anschliessend am Rücken und hatte mehrere blaue Flecken. Noch immer kümmerte sich aber kein Mensch um uns, obwohl klar war, dass wir Gewalt erleben. Meine Tochter konnte wegen den Verletzungen am Rücken anschliessend nicht schlafen und war laut. Dies führte dazu, dass sich eine Krankenpflegerin im Camp mein Kind anschaute. Sie setzte sich nachher dafür ein, dass wir zu einer Ärztin konnten. Als diese die Verletzungen meines Kindes sah und erkannte, dass ihr Gewalt angetan wird, informierte sie die Polizei und das Spital.
Direkt nachdem ich und meine Tochter von meinem Mann geschlagen wurden, wollte ich mich von ihm trennen und scheiden lassen. Ich kämpfte jeden Tag für den Schutz von meinem Kind und mir, doch ich bekam keine Unterstützung und konnte keinen Anwalt sehen. So vergingen sechs Monate. Solange war ich an meinen Mann gebunden, da unser Asylantrag als Familie behandelt wurde. Ich selbst wurde praktisch nirgends nach meinen eigenen Kontaktdaten gefragt und so lief immer alles über meinen Mann, was nicht nur in dieser Situation schlimme Folgen für mich hatte. Die Scheidung war dann erst nach zwei Jahren abgeschlossen und mein Ex-Mann wurde viel zu spät bestraft.
Mehr als drei Wochen waren meine Tochter und ich im Spital. Dort konnte ich ein erstes Mal auch meine Verletzungen zeigen. Anschliessend fragte ich «Wohin gehen wir nun?». Ich bekam die Antwort, dass ich ins gleiche Camp zurückkehren müsse, einfach in ein anderes Zimmer, denn mein Mann war immer noch da. Oder aber ich könne zu meiner Schwester, welche bereits in der Schweiz lebt, wodurch ich allerdings keine Unterstützung mehr vom Staat erhalten würde, ausser die Krankenkasse. Anspruch auf eine Unterbringung im Frauenhaus hatte ich nicht, da ich keine Aufenthaltsbewilligung hatte. Da ich sicher nicht zu meinem Ex-Mann zurückkehren wollte, entschied ich mich, zu meiner Schwester zu gehen.
Die nächsten sechs Monate waren die schlimmsten meines Lebens. Für die Trennung von meinem Ex-Mann, wurde ich als Schande der Familie angesehen. Die Familie meiner Schwester wollte auch meine Tochter nicht akzeptieren und sagte, sie gehöre zu ihrem Vater. Also meinem Ex-Mann, der sie geschlagen hatte! Meine Tochter und ich mussten uns ständig anhören, wie schlimm wir sind. Zum Beispiel sagten sie «Du musst das Essen deines Kindes selbst bezahlen». Mein Ex-Mann hingegen musste sich nie anhören, was er Schlimmes getan hat. Für mich war das unerträglich. Doch ich wollte nicht sagen, wie schlimm ich und mein Kind bei der Familie meiner Schwester behandelt wurden, denn dann hätten wir wieder zu meinem Ex-Mann ins Asylcamp gehen müssen. Ich konnte also zwischen Hölle und Hölle entscheiden…“
Amira*, Geflüchtete
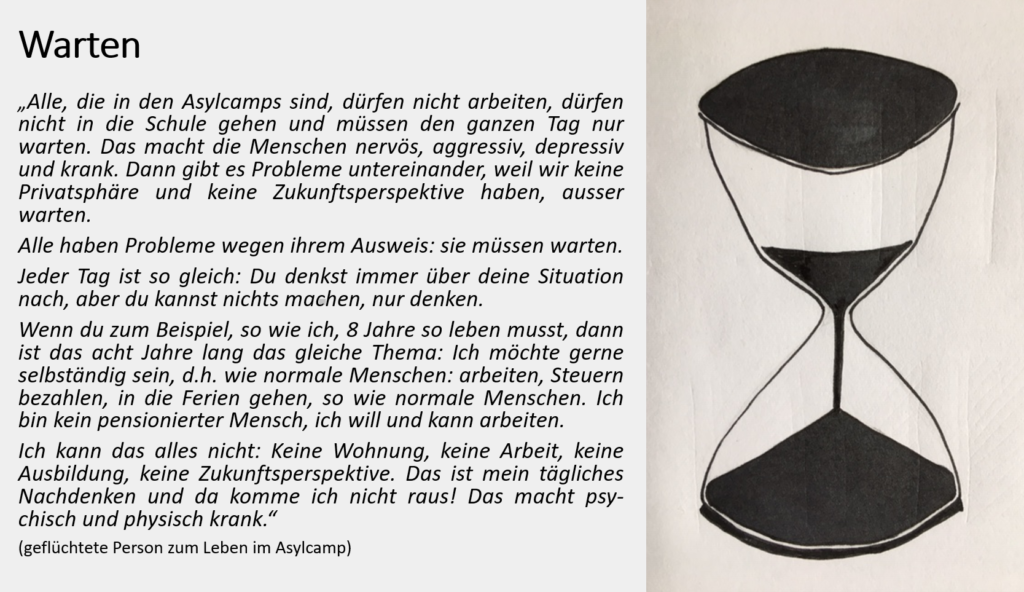
Le bus dans lequel je suis la seule à être assise quitte la place du village. Le paysage aride et désert défile sous mes yeux alors que grésille à la radio un chant traditionnel grecque. Après une bonne dizaine de minutes passées à faire semblant de capter ne serait-ce qu’une seule phrase que le chauffeur me balance en souriant, je l’aperçois au loin. Plus nous nous rapprochons, plus la clôture ornée de fils barbelés devient réelle. Je peux même entrevoir l’intérieur du site: une centaine de containers parfaitement alignés les uns derrière les autres et, à l’entrée, des véhicules militaires, un
poste de garde et le drapeau du pays, presque en berne. Aucun doute, je suis arrivée. Je descends, sans trop savoir ce que je fais là. Un groupe d’enfants accourent et me sortent de mes pensées. Ils me demandent mon nom et celui de mon pays. À leur tour ils se présentent. Âgés entre 2 et 11 ans, ils parlent arabe, français, kurde, anglais et même grec pour l’infime partie qui a la chance d’être scolarisée à l’école primaire du coin. Pour les autres, ce sera « l’école » du camp, donnée par un ancien enseignant syrien et qui n’a lieu que lorsque les locaux sont libres. Le responsable me fait une rapide visite des lieux. Chaque container est habité par 4 à 10 personnes, regroupées par famille ou par affinités, liens d’amitiés tissés lors du périple qui les a mené jusqu’ici. Le camp de Katsikas est le mieux équipé de la région. Cela me choque. « C’était bien pire il y a quelques mois. » m’explique cette jeune mère iranienne qui nous accueille chez elle pour le dîner. « Mon mari et moi avions vraiment peur de donner naissance à notre fille dans ces conditions, il faisait jusqu’à -15 en janvier. »
1’452, c’est le nombre de personnes qui résident ici. Ils viennent de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, de Guinée…. ils n’ont ni la même culture ni la même religion. Mais qu’importe: « ici, nous n’avons plus de personnalité, pas de dignité humaine. Nous ne sommes plus que la marchandise de l’Europe. » me confie un jeune Guinéen de mon âge, installé ici depuis l’ouverture du camp en 2016. De cette misère est née une profonde solidarité entre les habitants. Chacun aide son voisin du mieux qu’il peut, peu importe s’ils parlent la même langue ou non, c’est la coutume.
18:00, je rentre chez moi la tête pleine de questionnements. C’est vrai, les journalistes en font parfois trop. Mais là, je crois qu’ils n’en font pas assez. Ou alors, nous nous sommes juste habitués, lassés puis délaissés de cette misère qui nous paraît si loin mais qui est pourtant si près. Je ne sais pas. Les derniers rayons du soleil réchauffent ma peau. J’attrape un bol de Nesquik et m’installe sur la terrasse. Devant moi, le lac de Ioannina. Du fond de mes pensées resurgit une chanson de Gaël Faye: « Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. »
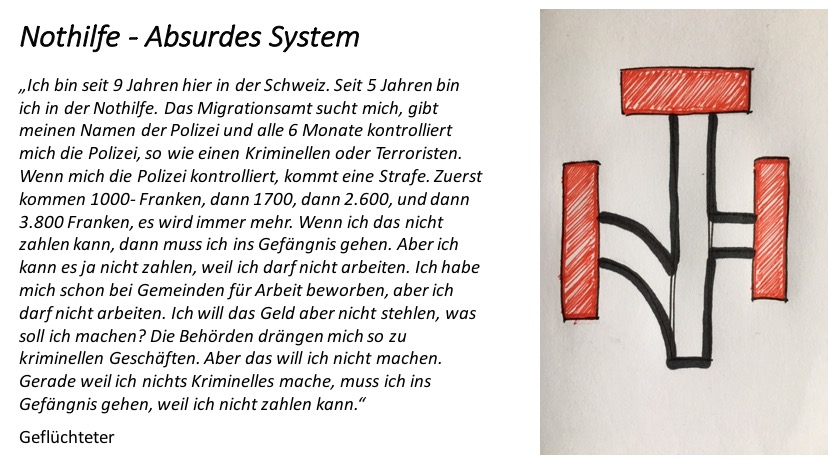
Cinq ans et demi, tu me le montres avec tes doigts, c’est plus simple. Ton langage est comme cet endroit: multiculturel. On t’a pris ta patrie, ton foyer, avant même que tu ne saches parler. Alors tu as improvisé, créant ton propre jargon: un mélange de divers dialectes entendus par-ci par-là, de la Syrie jusqu’ici. Ça fait tellement longtemps que tu es là que tout le monde te connaît et tu connais tout le monde. Même le gardien, les éboueurs, les militaires et les livreurs (surtout celui qui ramène du boulghour à la fin du mois). Les vieux postés devant le portail te surnomment « the crazy child », mais ton vrai prénom c’est Sahaalham. Je crois que je n’ai jamais su le prononcer correctement, mais bon, tu n’as cessé de m’appeler « Lya », alors je crois qu’on est quitte. Chaque matin, tu te tiens devant la porte, le sourire aux lèvres, tu nous attends. Et lorsque l’on rentre le soir, tu cours contre le grillage nous faire des grimaces. Ce même grillage qui te sépare du monde réel, qui met un terme à ta liberté. Et alors que les autres enfants de ton âge sont en vadrouille ou à l’école, toi, tu nous aides au jardin. À l’école, tu n’y vas pas très souvent. Faut dire que tu préfères entraîner les chiens errants du coin plutôt que ton vocabulaire d’anglais. Et l’on ne peut t’en vouloir pour ça. On te fera la leçon le jour où l’on sera capable de t’offrir une vraie éducation, ou du moins un espoir d’avenir. En attendant, tu te débrouilles à ta manière, comptant les voitures qui passent sur la route côté droit et improvisant ton grec en discutant avec la veille d’en face. D’ailleurs, je crois qu’elle t’aime bien, même si elle n’a rien à voir avec toi, que tes jeans sont toujours troués et tes cheveux pas lavés. C’est vrai, à première vue, tu peux paraître étrange. Les vieux du portail n’ont peut-être pas si tord finalement. Mais toi, tu vis dans le container numéro 72, camp A. Entassé à sept dans dix mètres carrés, tu n’as pas de place pour t’apprêter. De toute manière, ce genre de confort, ça fait bien longtemps que tu ne t’y intéresse plus. Ce qui t’importe à toi, c’est de prendre ton bain de soleil quotidien, à défaut de ne jamais avoir vu de vrais baignoires. C’est d’attendre jeudi pour venir chercher ton litre de lait hebdomadaire, c’est de trouver un nouvel insecte farfelu qui complétera ta collection, c’est de sauter dans les flaques et de courir assez vite pour éviter les sermons de ton père, c’est d’avoir une vie à peu près normale pour une enfant de ton âge. Et je suis désolée que ce ne soit pas le cas Sahaalham.
Désolée que le monde te soit présenté ainsi: incompréhensible, monotone et dénué de sens. Désolée que tu ne trouves jamais le sommeil la nuit, ta mémoire étant saturée d’horreurs, de souvenirs ignobles. Les flaques de sang, les cris, les pleurs, les coups de feu, les morts. Tu n’es pas née au bon endroit, ni au bon moment. On n’a pas eu les mêmes chances au départ toi et moi. Et pourtant, rien ne t’arrêtes. Tu ne laisses pas tomber la vie, même si celleci n’a jamais misé sur toi. Chaque jour qui passe, tu ris, tu joues, tu cours, tu souris, tu danses, tu fais face à ta douleur. Peut être que tu finiras par l’abattre ton malheur. Et un jour, je l’espère, tu le connaîtras aussi, le goût de la Liberté.
Nous sommes le 20 avril 2019. Tu es là depuis plusieurs mois, moi plusieurs jours. Et c’est aujourd’hui que nos routes se séparent. Le chemin fut bref mais suffisamment intense pour marquer mon coeur à jamais. Merci pour toutes ces belles leçons d’humanités. C’est une véritable claque que je me suis prise en faisant ta connaissance. La même que j’aimerais mettre à tous ces dirigeants responsables qui restent passifs devant tant d’injustices. Que les vents te mènent petit soleil, prends soin de toi. Je te souhaite des bonheurs aussi grands que les miens. Et surtout n’oublie pas, malgré ce que disent les vieux du portail: tu n’es pas folle Sahaalham, c’est le monde qui l’est.
Interview auf Deutsch: „Im Asylcamp wirst du zum Zombie“